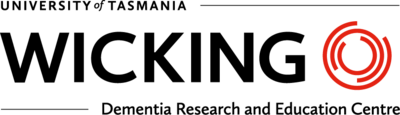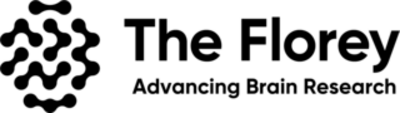En région Pays de la Loire, les artistes protestent contre des coupes drastiques dans les subventions culturelles (-62 %), menaçant festivals, théâtres et projets locaux. Si la dépendance de la culture institutionnelle vis-à-vis des collectivités territoriales est bien connue, celle des responsables politiques envers les artistes reste souvent dans l’ombre. En effectuant de telles coupes, les politiques oublieraient-ils leur propre dépendance aux artistes ?
La dépendance de nombreux élus vis-à-vis de la culture s’est accrue depuis les années 1980. Une dépendance qui renvoie largement à l’instrumentalisation croissante qu’ils ont pu en faire, c’est-à-dire aux manières dont de nombreux élus ont mis à contribution la culture pour satisfaire leurs ambitions dans des champs extra-artistiques.
Le pari culturel des acteurs politiques
Cette instrumentalisation s’est d’abord imposée dans les années 1980 par rapport à la question sociale. C’est en effet au moment des premières émeutes de banlieue, entre 1979 et 1982, que des projets artistiques ont commencé à être pensés et financés pour « recréer du lien social », selon la formule consacrée à l’époque. Les acteurs des arts de la rue ont été parmi les premiers à jouer ce rôle social (Royal de Luxe, Délices Dada, Ilotopie, Les Piétons, Le Phun, Kumulus, Oposito, la Compagnie OFF, Décor Sonore, L’illustre Famille Burratini, Cacahuète, etc.). Cela représentait pour eux une opportunité financière, mais aussi symbolique, l’argent public venant légitimer leur discipline jusque-là peu reconnue artistiquement.
Par la suite, le champ d’instrumentalisation culturel s’est élargi pour satisfaire des ambitions à la fois économique (développement touristique, industries créatives, etc.) et d’aménagement du territoire. Cette double tendance a pu s’appuyer sur une logique d’équipement avec pour modèle le musée Guggenheim de Bilbao (voire antérieurement le centre George Pompidou), archétype de requalification urbaine (c’est-à-dire le fait de changer la vocation initiale d’un quartier) par un projet culturel et un geste architectural. Pour des quartiers en friche, désertés par l’industrie, la culture a été mise au centre de la dynamique urbaine, comme sur l’île de Nantes ou le quartier Confluence à Lyon. La « festivalisation » des politiques municipales depuis les années 2000 et un autre aspect d’une volonté de développer une économie touristique fondée sur la culture.
Aujourd’hui, la tendance que le politologue Guy Saez appelle « l’hyper instrumentalisme culturel » s’est emparée des problématiques numériques, écologiques, des inégalités de sexe, etc. Il existe également une autre attente plus implicite du politique : les formes artistiques devraient être pédagogiques. Sensibilisation, éducation aux enjeux écologiques, aux inégalités de tous genres : pour les artistes, l’accès à la subvention semble de plus en plus conditionné à ce rôle pédagogique.
La culture à tout faire : hyper instrumentalisme et communication
La culture à tout faire révèle néanmoins la faiblesse du politique à inventer lui-même ses solutions sociales ou de développement économique. Il s’est ainsi instauré une sorte de « délégation de service public » à la culture. À tel point que le sociologue Jean Caune a pu parler de croyance magico-lyrique envers la culture, bonne à tout faire, les artistes se faisant tour à tour pompiers des banlieues ou travailleurs sociaux, acteurs économiques, urbanistes ou pédagogues. Les porteurs de projets et les artistes ont saisi l’opportunité de ce précieux soutien financier. Ils sont eux-mêmes venus alimenter le besoin politique, théorisant leur action pour mieux la vendre et démontrer son efficacité. Parmi les dernières notions en date, l’urbanisme culturel, qui voudrait « créer les conditions de la capacité à agir pour toutes les parties prenantes et influer sur les modes opératoires de la fabrique territoriale ». Cet urbanisme culturel révèle le paroxysme de cette interdépendance croissante entre projets d’aménagement et culture.
[Déjà plus de 120 000 abonnements aux newsletters The Conversation. Et vous ? Abonnez-vous aujourd’hui pour mieux comprendre les grands enjeux du monde.]
De plus, selon la logique du « est bon ce qui se voit », propice en période d’élections, la dépendance envers la culture vient aussi du fait qu’elle fait partie des quelques éléments tangibles, aisément et rapidement visibles de l’action politique. Au niveau local, cela explique probablement en partie le soutien accru aux projets artistiques événementiels dans l’espace public, caractéristiques des politiques municipales depuis les années 2000. De la même manière, pour les politiques d’équipements, payer un architecte dont la signature fera parler d’elle semble de bon ton, comme à Lyon avec Jean Nouvel ou à Nantes avec Alexandre Chemetoff. On mesure alors ce qu’il en coûterait aux politiques de se priver d’un tel instrument d’action, qui est également un outil de communication majeur.
De la déconnexion artistique et des véritables attentes des publics
Depuis les années 1980 s’est ainsi imposée comme une routine l’idée d’une utilité socio-économique, urbaine, pédagogique, des financements culturels. Une idée admise bien qu’« il n’existe aucune étude empirique proposant une estimation complète d’un tel impact » note l’économiste Yann Nicolas. Et la croyance est tenace. Comme le souligne le politologue Guy Saez :
« Ce n’est pas parce que de nombreux auteurs universitaires qualifient ces raisonnements de « bullshit » (ndlr : idiotie) qu’ils régressent ».
De plus, cette instrumentalisation semble bien mettre au second plan la véritable question artistique et celle des attentes des publics. Elle passe systématiquement sous silence le fait que cette culture institutionnelle intéresse peu de Français au-delà des milieux culturels eux-mêmes, comme l’a souligné la metteuse en scène Ariane Mnouchkine dans une tribune ayant fait grand bruit.
De cette relation de dépendance est né le monde de la culture institutionnelle, qui n’a fait que croître en 50 ans, pour devenir l’un des postes principaux de dépense publique de nombreuses communes, alors que le débat sur les dépenses culturelles semble absent à chaque élection et que le budget global du pays pour la culture dépasse les 25 milliards d’euros.
La nouvelle notion politique de conditionnalité des subventions formate toujours plus aujourd’hui les esthétiques et les contenus artistiques : ceux-ci doivent être des éléments pacifiants : ni trop critiques, ni trop excentriques et surtout inclusifs.
Plutôt que de couper « à la tronçonneuse » dans les subventions culturelles, peut-être faudrait-il les repenser et les recentrer sur des objectifs véritablement culturels. S’assurer qu’elles soutiennent des projets en phase avec les publics et que, même si elles restent instrumentalisées par le politique (soyons réalistes), cette instrumentalisation n’affecte pas les contenus artistiques.