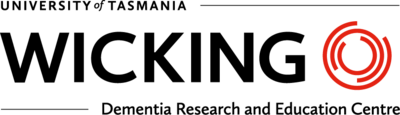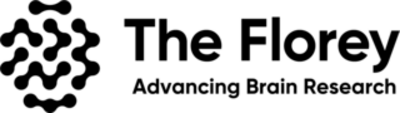Avec une production annuelle de 132 millions de livres de sirop d’érable dont la valeur est estimée à près de 393 millions de dollars, le Québec compte pour 89 % de la production canadienne des produits de l’érable.
Or, les vents violents qui ont balayé le sud du Québec dans les cinq dernières années ont causé des dégâts inquiétants pour les érablières et la production acéricole.
Dans certains secteurs, les érablières ont perdu jusqu’à 20 % de leurs arbres. Et ces arbres perdus sont souvent les érables matures utilisés pour la production de sirop.
Ces évènements météorologiques extrêmes semblent être de plus en plus fréquents. Ils réduisent le nombre d’érables qui peuvent être exploités pour la production acéricole, endommagent les systèmes de tubulures qui transportent la sève vers le lieu de récolte, et obligent finalement à réorganiser les entailles et les lignes de transport de la sève.
Les pertes en revenu et en équipement sont importantes, surtout quand les tempêtes surviennent à l’approche de la saison des sucres.
Les productrices et producteurs acéricoles s’interrogent sur l’évolution de tels évènements dans un contexte de crise climatique et sur les pistes d’action possibles.
Chercheurs spécialisés en écologie forestière et en biomécanique de l’arbre, nous proposons d’apporter un éclairage sur la nature de ce risque et les moyens d’y faire face. La mise en oeuvre de cet article est issue d'un travail de collaboration réalisé à l'Université du Québec à Chicoutimi.
Quels sont les dégâts causés aux arbres par le vent ?
Les dommages que peuvent infliger les vents forts aux arbres sont multiples. Dans un premier temps, les feuilles et des branches peuvent être arrachées, soit directement par des bourrasques ou indirectement à la suite de collisions avec des arbres voisins. La perte de feuilles et de branches n’est pas mortelle pour les arbres et peut même leur être bénéfique puisqu’elle réduit leur exposition au vent.
Par contre, lorsque la force du vent dépasse la résistance engendrée par l’ancrage des racines, l’arbre est déraciné et meurt. C’est ce qu’on appelle un chablis, soit un arbre renversé. Dans les cas plus dramatiques, les chablis peuvent concerner une grande partie ou la majorité des arbres d’un peuplement (un ensemble d’arbres comme une érablière, par exemple).
Si la résistance mécanique du tronc est dépassée avant celle des racines, il casse. On parle alors de volis. Cependant, il arrive que des arbres survivent grâce aux bourgeons qui se développent chez certaines espèces à partir de la souche ou de racines restées ancrées dans le sol.

Vulnérabilité face au vent
La vulnérabilité d’un arbre exposé au vent dépend du rapport entre le chargement mécanique induit par le vent et la résistance de l’arbre (engendrée par l’ancrage des racines dans le sol ou par la résistance du tronc).
Le chargement dépend de la vitesse du vent et de la morphologie de l’arbre. Plus l’arbre a de feuilles et de branches, plus il est exposé au vent. Et plus l’arbre est haut, plus l’effet de levier démultiplie la force exercée par le vent.
Ainsi, les arbres sont moins vulnérables au vent lorsque leur exposition au vent est faible et que leur résistance est forte.
À l’échelle d’un peuplement, la vulnérabilité augmente fortement après un changement brusque de son exposition au vent. Ce changement peut être dû à une ouverture, artificielle ou non, de la canopée. Par exemple, la chute des feuilles à l’automne réduit l’exposition au vent. En milieu tempéré, les tempêtes hivernales causent donc souvent plus de dégâts chez les conifères, puisque ces arbres gardent leurs aiguilles.
Quels sont les principaux facteurs de vulnérabilité ?
Au Québec, le bouleau jaune et l’érable sont les espèces feuillues les plus résistantes au déracinement par le vent. Les érables les plus vulnérables au chablis sont ceux dont les racines ne sont pas ancrées profondément dans le sol, par exemple lorsque le sol est mince ou mal drainé. De façon générale, un mauvais drainage engendre un sol gorgé d’eau, ce qui affaiblit l’ancrage des racines. C’est pour cette raison qu’une tempête accompagnée de fortes pluies provoque davantage de chablis. En revanche, un sol gelé renforce l’ancrage racinaire.
Dans un peuplement dense, où le vent pénètre peu, les arbres sont peu exposés au vent. Mais ils ont généralement un tronc fin et des branches concentrées au sommet. Cette forme rend les arbres vulnérables face au vent si la charge mécanique augmente soudainement. Au-delà d’une certaine hauteur, un peuplement dense peut subir de graves dégâts en cas de tempête. La chute d’un arbre entraîne celle de ses voisins, et ainsi de suite, ce qui augmente l’exposition des arbres restants. Cela mène souvent à la création de couloirs d’arbres abattus.
L’éclaircie est une pratique sylvicole qui consiste à réduire la densité du peuplement en abattant un certain nombre d’arbres pour stimuler la croissance des arbres restants. Cependant, elle facilite aussi la pénétration du vent, et donc accroît les risques, surtout dans les premières années après l’éclaircie. Cette augmentation des risques est néanmoins temporaire, puisque l’acclimatation est l’un des atouts majeurs des arbres pour faire face au vent.
Quels seront les impacts des changements climatiques ?
Un effet direct du réchauffement climatique est la prolongation de la période sans gel. Conséquence ? L’ancrage du système racinaire des arbres sera affaibli au début et à la fin de l’hiver, les rendant plus vulnérables au déracinement.
Dans son sixième rapport, le Groupe international d’experts sur le climat (GIEC) commence à faire des pronostics sur la fréquence et l’intensité des tempêtes pour certaines régions du monde. En Amérique du Nord, les évènements venteux extrêmes garderont la même fréquence, mais seront plus puissants.
La saison des orages va s’allonger aux États-Unis, et possiblement au sud du Canada. Il y aura notamment plus d’orages au printemps, au moment de la pousse des feuilles, ce qui augmentera le risque de dégâts pour les feuillus. Les cyclones extratropicaux qui touchent l’Amérique du Nord et l’Europe seront accompagnés de plus fortes précipitations, ce qui pourrait affaiblir l’ancrage racinaire des arbres.
Selon les observations d’Ouranos, le sud du Québec n’est pas à l’abri des tornades, qui se concentrent particulièrement dans les mois de juin et juillet et qui ont déjà causé des dommages importants aux infrastructures et aux paysages.
La combinaison de ces changements annoncés met en lumière l’enjeu de la résistance au vent des peuplements.
Quelles pratiques sylvicoles pour réduire le risque vent ?
Les forêts denses avec des arbres élancés finissent par être très vulnérables aux tempêtes. D’un autre côté, les éclaircies augmentent temporairement les risques de casse et de déracinement. Le défi est donc d’élaborer de nouvelles pratiques sylvicoles qui minimisent les risques à tous les stades de développement d’un peuplement. L’éclaircie pourrait par exemple être pratiquée de façon précoce lorsque les arbres sont jeunes afin de minimiser l’augmentation du risque lié au vent.
La crise climatique engendre d’autres menaces telles que les sécheresses et les attaques d’insectes. Les premières victimes des insectes sont souvent des arbres affaiblis par la sécheresse ou partiellement déracinés par le vent. Pour atténuer les effets des sécheresses, on pratique parfois des éclaircies très fortes et tardives. Cette technique réduit la compétition pour l’eau entre les arbres, mais augmente subitement leur exposition au vent.
D’autre part, la récolte de la sève pour la production de sirop d’érable prive l’arbre d’une partie de ses sucres, ce qui diminue les ressources disponibles pour se renforcer face au vent.
Les risques ne sont donc pas indépendants les uns des autres et devraient être considérés simultanément. Une réflexion globale est nécessaire, ainsi que des avancées scientifiques sur la question des aléas multiples, successifs ou non.
La forêt a la capacité de s’acclimater aux aléas. Les professionnels impliqués se doivent de favoriser cette acclimatation.