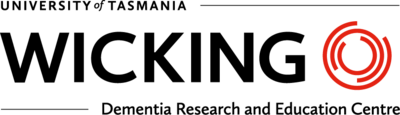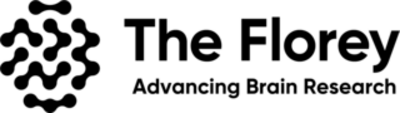Les stratèges canadiens commençaient à peine à se remettre du choc provoqué par les récentes menaces de Donald Trump d’imposer des droits de douane de 25 % au Canada et au Mexique quand le président désigné a balancé un nouvel explosif rhétorique. Dans un message publié la nuit sur les médias sociaux, Trump a fait référence au « grand État du Canada » et au « gouverneur Justin Trudeau ».
Pendant que les ministres canadiens affirment ne pas prendre au sérieux les moqueries de Trump, le Canada répond à la menace tarifaire par une stratégie sur deux axes.
Premièrement, on cherche à démontrer les avantages économiques concrets d’un commerce bilatéral. La visite de Trudeau à Mar-a-Lago, organisée à la hâte le 29 novembre, avait pour but de communiquer cette perspective à Trump et à ses conseillers. Cela ne semble toutefois pas avoir été couronné de succès étant donné que Trump a parlé de la rencontre de manière sarcastique dans un message sur Truth Social où il se moque de Trudeau et du Canada.
Deuxièmement, des politiciens canadiens cherchent à tirer parti du côté obscur de la politique commerciale de Trump, en suggérant d’aligner le Canada sur les États-Unis contre le Mexique, accusant ce dernier d’être une voie d’accès pour les importations chinoises et de constituer une menace pour la sécurité nationale.
Qu’est-ce qui est en jeu exactement au moment où un Trump débridé s’apprête à devenir pour une deuxième fois président des États-Unis ?
Nous considérons que la réponse se trouve non seulement dans des raisonnements économiques, mais aussi et surtout dans des explications psychanalytiques. La stratégie politique est souvent fondée non pas sur des objectifs économiques rationnels, mais sur des désirs irrationnels qui poussent parfois les politiciens vers des fins destructrices.
La psychologie qui sous-tend l’idéologie
Dans notre récent ouvrage où nous abordons la psychanalyse et la politique, nous affirmons que les médias et les stratèges minimisent trop souvent l’importance du désir inconscient dans la politique et l’économie de tous les jours.
Nous pensons que les idéologies — qu’il s’agisse du « libre-échange », du « libre choix » ou du slogan « Make America Great Again » — ne constituent pas un simple cri de ralliement lancé par des leaders, mais sont plutôt des idées séduisantes que les politiciens et les électeurs souhaitent inconsciemment, quelles qu’en soient les répercussions.
Le « commerce » devient alors plus que la somme des parties économiques ; il est aussi très émotionnel et même fétichisé, imprégné qu’il est d’attentes quasi magiques qui défient le bon sens et la prudence économiques.
La campagne électorale de Donald Trump s’est appuyée avec succès sur cet attrait émotionnel, en exploitant les frustrations économiques de la population face à la montée en puissance de la Chine et au déclin relatif des États-Unis. Il a présenté le commerce et les droits de douane comme des outils permettant de « rendre sa grandeur à l’Amérique ».
Le Canada, quant à lui, s’est retrouvé dans le collimateur, cherchant à apaiser les États-Unis tout en devenant la cible du populisme de Trump.

Le Canada : partenaire ou cible ?
Avant l’élection américaine, le Canada a voulu s’aligner sur les États-Unis dans sa guerre commerciale contre la Chine, en annonçant des droits de douane de 100 % sur les véhicules électriques chinois et de 25 % sur l’acier et l’aluminium chinois.
Ce raisonnement mercantiliste obéit à une logique économique. Ainsi, la stratégie de Trump consiste à utiliser des outils de protection pour réaffirmer la domination des États-Unis dans les secteurs où le pays a pris du retard. Le Canada et le Mexique sont sommés de se joindre au mouvement ou de rester en plan, et les droits de douane canadiens à l’encontre de la Chine pourraient en découler.

Le Canada a également réagi en répétant les accusations américaines à l’encontre du Mexique. Le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, a suggéré que le Canada devrait envisager un accord commercial bilatéral avec les États-Unis qui exclurait le Mexique.
La vice-première ministre Chrystia Freeland, tout en exprimant un soutien provisoire à l’accord commercial trilatéral, a reproché au Mexique de ne pas agir de la même manière que le Canada et les États-Unis en ce qui concerne ses relations économiques avec la Chine. Et ce, malgré le fait que le Canada s’est montré aussi engagé dans le commerce avec la Chine que le Mexique.

Déjà des milliers d’abonnés à l’infolettre de La Conversation. Et vous ? Abonnez-vous aujourd’hui à notre infolettre pour mieux comprendre les grands enjeux contemporains.
Mais quand Trump a annoncé fin novembre son intention d’imposer des droits de douane au Canada et au Mexique, et qu’il a également exigé la fin de l’immigration illégale et du trafic de drogue à travers la frontière, les élus canadiens ont été stupéfaits. Ford a exprimé son désarroi en déclarant : « Nous comparer au Mexique est la chose la plus insultante que j’aie jamais entendue de la part de nos amis et plus proches alliés. »
Quelques jours plus tard, le Canada s’est engagé à augmenter ses dépenses en matière de sécurité frontalière, dans un effort apparent pour apaiser les États-Unis.
Attiser les inquiétudes des Américains
L’enjeu de l’idéologie populiste de Trump n’est pas seulement l’économie, mais aussi le statut mondial des États-Unis.
Avec la montée en puissance de la Chine, ce statut est perçu comme menacé, ce qui inquiète les Américains. Le résultat des élections laisse entrevoir un désir nostalgique de retrouver la « grandeur » passée de l’Amérique en éliminant tous les obstacles sur son chemin.
Bien que Trump se soit montré habile à exploiter ce désir, l’irrationalité de sa politique populiste s’avérera vraisemblablement contre-productive. Plutôt que de s’attaquer aux problèmes économiques et commerciaux structurels des États-Unis — une inégalité des revenus sans précédent et une grande précarité de l’emploi, par exemple —, il fait une démonstration de force et joue à un jeu de domination.
Il s’agit d’une tactique classique d’un point de vue psychanalytique : au lieu de s’occuper de ses propres échecs, on les transfère sur un autre stéréotypé — la Chine, les migrants, les musulmans, etc.
C’est ce qui ressort des tentatives de Trump de présenter les Mexicains comme de « mauvais hombres » qui sont à l’origine d’une « invasion de notre pays » par la drogue et les immigrants clandestins, tout en faisant prétendument « fortune grâce aux États-Unis ».
Pourtant, bien que le Mexique ait enregistré des gains économiques depuis quelques années, il est resté loin derrière les États-Unis et le Canada en matière de croissance de la productivité et des revenus au cours des 30 dernières années.
En mettant l’accent sur d’éventuels investissements chinois dans l’industrie automobile mexicaine — une seule usine automobile appartenant à la Chine se trouve actuellement au Mexique —, Trump détourne l’attention de l’échec persistant de l’industrie automobile américaine dans ses efforts pour suivre l’évolution de la technologie chinoise.
Cependant, la stratégie de Trump, qui consiste à exploiter les craintes des Américains en utilisant le protectionnisme commercial, risque de se retourner contre lui. Cela pourrait stimuler temporairement le sentiment nationaliste et apaiser certains fabricants américains, mais bientôt les consommateurs américains subiront une hausse des prix, tandis que les producteurs pourraient pâtir des prix plus élevés du pétrole et du gaz en provenance du Canada.
La Chine pourrait également cibler l’agriculture américaine en réponse aux nouveaux droits de douane imposés par Trump, ce qui aurait des répercussions négatives sur les zones rurales qui ont apporté un soutien politique à Trump.

L’irrationalité du désir populiste
L’irrationalité des politiques protectionnistes populistes de Trump saute aux yeux. Pas étonnant que les représentants de la Chine soulignent que « personne ne gagnera une guerre commerciale ou tarifaire ».
En ce qui concerne le Canada, il est peu probable que le fait d’amadouer Trump ou de trahir le Mexique suffise à apaiser le président désigné. Au contraire, cela pourrait constituer la preuve que l’intimidation est une bonne tactique et qu’il est possible d’obtenir davantage de concessions.
Les dernières railleries de Trump à l’égard de Trudeau laissent croire que l’escalade de l’intimidation sera une tactique présidentielle courante dans les mois et les années à venir — comme si nous en avions besoin…