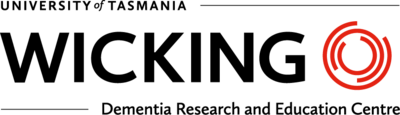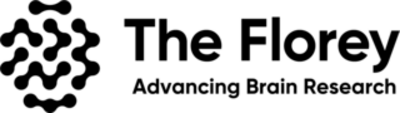Les régimes autoritaires s’appuient sur des structures patriarcales pour asseoir leur pouvoir. En Iran, cette alliance se manifeste par un contrôle des corps féminins.
À travers des lois vestimentaires strictes, notamment la loi sur le port du voile obligatoire, et des sanctions punitives, les femmes sont façonnées en « corps-objets », en vitrines d’une propagande qui incarne l’autorité morale et politique du régime.
À cette appropriation de leur corps, les femmes iraniennes ont toujours répondu par une résistance. En Iran aujourd’hui, cette lutte prend une nouvelle ampleur : chaque geste de désobéissance transforme leur chair opprimée en outil d’émancipation et devient une déclaration politique, symbole d’une quête acharnée pour la liberté et la dignité, même au prix de leur vie.
Je suis sociologue, irano-canadienne, candidate au doctorat en études féministes et des genres à l’Université d’Ottawa. Mes recherches portent sur les modalités de résistance des femmes iraniennes face aux lois discriminatoires depuis la révolution de 1979. En tant que militante féministe et chercheuse, je m’intéresse particulièrement aux mouvements de femmes en Iran, qui luttent contre l’apartheid des genres pour l’émancipation et l’égalité, offrant une inspiration précieuse au féminisme universel.
La performance d’autonomie corporelle
Ahou Daryaei, étudiante en langue française à l’Université Azad de Téhéran, est devenue l’un des récents symboles de cette lutte. Agressée par la police des mœurs pour des vêtements jugés « inappropriés », elle a répondu par un acte radical : retirer ses vêtements — apparemment déchirés — et se tenir debout, vulnérable, mais puissante.

En un instant, son corps s’est transformé en un message, une contestation de l’autorité oppressive du régime. Cette image, partagée sur les réseaux sociaux, a inspiré une vague de solidarité nationale et internationale, démontrant l’impact immédiat et universel de ces performances de désobéissance corporelle. La jeune femme a été envoyée en institut psychiatrique.
Quelques jours plus tard, Arezou Khavari, adolescente afghane issue d’un quartier défavorisé de Téhéran, a mis fin à ses jours en se jetant du toit de son école après avoir été harcelée pour avoir porté un jean sous son uniforme scolaire.

Déjà des milliers d’abonnés à l’infolettre de La Conversation. Et vous ? Abonnez-vous aujourd’hui à notre infolettre pour mieux comprendre les grands enjeux contemporains.
Dans cet acte désespéré, on retrouve une ultime performance de résistance : vêtue de son jean et sans hijab, Arezou a rejeté un système qui tentait d’effacer son identité. Cette jeune fille subissait une triple marginalisation, en tant que réfugiée femme et habitante d’un quartier populaire, dans une société qui réserve un mépris particulier aux Afghanes.
Malheureusement, elle fait partie des nombreuses adolescentes qui, en moins d’un an, ont été poussées au suicide après avoir subi du harcèlement et des agressions de la part de leur famille ou de leur école en raison de leur résistance aux règles strictes sur leur apparence et les codes vestimentaires.
Mahsa Jina Amini, une jeune femme kurde de 22 ans, est décédée le 16 septembre 2022 après avoir été arrêtée et violemment agressée par la police des mœurs à Téhéran pour un port du voile jugé « inapproprié ». Sa mort a déclenché le mouvement Femme, Vie, Liberté, une vague de protestations massive et sans précédent en Iran contre le régime et ses lois discriminatoires, notamment le port obligatoire du voile.

Du corps-objet au corps-sujet
Ces résistances s’inscrivent dans une continuité où chaque geste de désobéissance corporelle, porté par des femmes et des jeunes filles, pousse la lutte un pas de plus en avant.
Vida Movahed, en 2017, a brandi son voile sur un bâton, une performance simple, mais radicale qui a marqué un tournant dans la résistance publique des femmes iraniennes.
Nika Shakarami, adolescente de 16 ans, a bravé les interdits en brûlant son hijab et en scandant « Femme, Vie, Liberté » avant d’être brutalement violée et assassinée par les forces du régime.

Ces actes de révolte, bien que réprimés par une violence extrême, ne se sont pas limités aux frontières de l’Iran. Rappelons-nous Aliaa Magda Elmahdy, qui, en Égypte en 2011, a publié une photo d’elle nue, posant avec une confiance provocante, ciblant non seulement un régime autoritaire, mais aussi le patriarcat qui cherchait à restreindre son corps à la honte et à la pudeur.
Le corps des femmes, qui a longtemps été l’instrument du contrôle patriarcal et idéologique des femmes, devient aujourd’hui pour elles une arme d’émancipation. Chaque geste, à travers sa puissance symbolique, reconfigure les normes patriarcales et donne à cette lutte une portée universelle, défiant l’autorité et redéfinissant l’autonomie des corps féminins.
L’institut psychiatrique pour les femmes qui résistent
Le cas d’Ahou Daryaei, accusée par le régime de souffrir d’instabilité mentale et envoyée en hôpital psychiatrique après avoir protesté contre le port obligatoire du hijab, illustre la pathologisation systématique de la dissidence féminine.
Cette tactique a récemment pris une ampleur institutionnelle avec l’annonce de la création de cliniques spécialisées pour « traiter psychologiquement » les femmes dévoilées, transformant leur résistance en un « trouble mental » nécessitant une intervention pseudo-scientifique.
Cette pratique n’est pas sans rappeler les chasses aux sorcières médiévales, où les femmes transgressives étaient accusées de pactes démoniaques pour justifier leur persécution, comme l’a analysé la philosophe Silvia Federici dans « Caliban et la sorcière ». Ces institutions disciplinaires contemporaines cherchent à discipliner les corps et les esprits pour maintenir un ordre patriarcal autoritaire.

Dans « Histoire de la folie à l’âge classique », le philosophe et historien Michel Foucault montre comment la folie a été historiquement construite pour marginaliser les individus déviants, notamment les femmes dont les comportements contestaient les normes établies.
En Iran, ce processus se manifeste dans la récente psychiatrisation de trois actrices célèbres qui ont refusé de porter le hijab. Les autorités les ont de fait déclarées « mentalement instables ».
Ces mesures disqualifient leurs actes politiques et reflètent un mécanisme biopolitique où, sous couvert de « soin » et de « traitement », le régime impose un contrôle absolu sur les corps féminins, transformant la résistance collective en pathologie.
De corps-objets à sujets d’émancipation
Ces performances corporelles — brûler un hijab, danser en public, se dévêtir ou même mourir en défiant les règles — incarnent la performativité que décrit la philosophe Judith Butler.
Par leurs gestes, ces femmes redéfinissent les normes et se réapproprient leurs corps, autrefois des « objets » du patriarcat, pour en faire des « sujets » d’émancipation. Cette transition vers l’auto-subjectivation représente une prise de pouvoir fondamentale : leur corps ne se plie plus aux « normes » imposées par le régime, mais devient un espace de liberté et de résistance.
Ces résistances, bien qu’ancrées dans un contexte spécifique, reflètent ce que la féministe et écrivaine française Martine Storti appelle « le potentiel émancipateur du féminisme universel », où les luttes pour la liberté transcendent les frontières géographiques et culturelles. Pour Storti, l’universel n’impose pas un modèle unique de libération, mais se nourrit de la diversité des expériences et des combats, en reconnaissant leur capacité à transcender les frontières culturelles et politiques.
Le slogan « Femme, Vie, Liberté » est bien plus qu’un cri de ralliement : c’est une promesse de transformation, une affirmation que la liberté et la justice ne sont pas des privilèges, mais des exigences fondamentales. Chaque femme, par son courage, écrit une page d’histoire où la quête d’autonomie corporelle devient un acte collectif et une aspiration universelle à vivre librement contre les systèmes oppressifs.