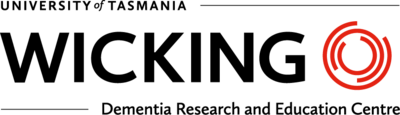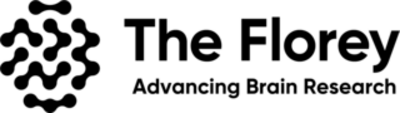Lancée en 2017 lors du premier sommet de la route de la soie (BRI, Belt and Road Initiative), la route de la soie numérique, volet numérique du mégaprojet d’infrastructures chinoises, est passée quasiment inaperçue à l’international. Pourtant, ce nouveau volet modifie de manière non négligeable la route de la soie chinoise. Via cette route numérique, la Chine accorde notamment un poids de plus en plus important à des entreprises chinoises privées concernant ses politiques étrangères.
Mais alors, pourquoi si peu d’intérêt pour cette route de la soie numérique ?
C’est que pour beaucoup, celle-ci n’est qu’un énième pas dans l’effort continu du gouvernement chinois et des entreprises d’État chinoises afin d’accroître ses ressources énergétiques, ses positions stratégiques ou encore son influence à l’international.

Déjà des milliers d’abonnés à l’infolettre de La Conversation. Et vous ? Abonnez-vous aujourd’hui à notre infolettre pour mieux comprendre les grands enjeux contemporains.
En effet, en Occident, la BRI est souvent étroitement associée à l’ambition hégémonique de la Chine. J’estime que c’est toutefois méconnaître l’essentiel des enjeux en cause.
En tant que candidate au doctorat en science politique à l’Université de Montréal, je mène des recherches sur les interactions du gouvernement chinois, des entreprises privées chinoises et des institutions locales dans les projets de la route de la soie numérique en Asie du Sud-Est.
Je relève notamment trois nouvelles dynamiques dans le rapport public-privé concernant la route de la soie numérique qui font en sorte qu’on doit lui accorder le plus grand des sérieux.
Mobilisation des acteurs privés
La première de ces dynamiques concerne le rôle clé des entreprises privées chinoises.
Contrairement aux autres projets de la BRI, les projets de la route de la soie numérique sont menés majoritairement par des entreprises privées chinoises. Par exemple, pour les infrastructures de télécommunication et de 5G, on trouve Huawei et ZTE. Pour la plate-forme d’e-commerce et de fintech, Alibaba se taille la part du lion.
Certes, ces entreprises sont inévitablement sous l’influence du gouvernement chinois, mais force est de constater qu’elles sont davantage orientées vers les bénéfices économiques et la taille du marché que vers l’énergie ou les enjeux géopolitiques.
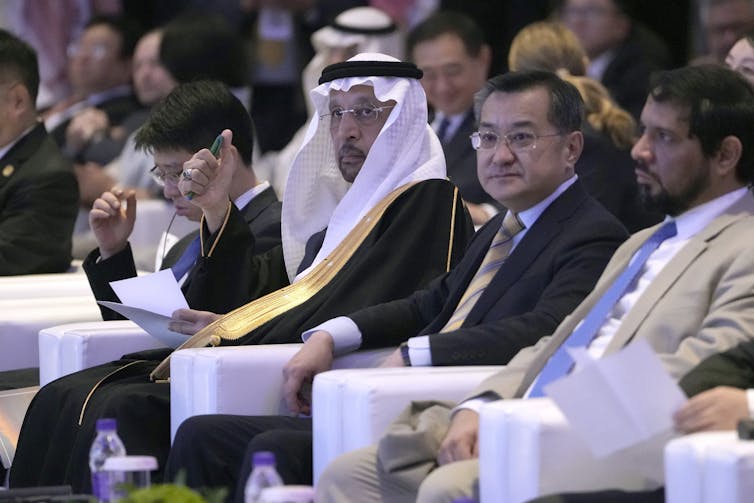
Prenons l’exemple de l’Asie du Sud-Est, l’une des régions recevant le plus grand nombre de projets de la route de la soie numérique. Les projets numériques sont beaucoup plus présents dans les pays qui bénéficient d’institutions stables et d’une économie en forte croissance, tels que l’Indonésie, la Malaisie et Singapour. Les entreprises chinoises technologiques ont plusieurs atouts dans la région :
Une présence de longue date, remontant au début des années 2000.
Des prix compétitifs pour la construction d’infrastructures numériques, qui sont souvent très coûteuses en capitaux.
Des programmes de formation destinés aussi bien aux institutions de recherches qu’aux gouvernements et entreprises.
Des échanges de technologies.
Si en Europe et aux États-Unis, pour des raisons de sécurité, les projets de route de la soie numérique portés par les géants numériques chinois sont de plus en plus remis en question, il faut reconnaître que la perspective des pays d’Asie du Sud-Est est tout autre : le numérique représente un levier économique et une amélioration des services publics, lesquels demeurent une priorité gouvernementale.
En ce qui concerne la sécurité, pour beaucoup de dirigeants dans la région, les entreprises chinoises ne posent pas plus de dangers que les géants américains ou européens.
L’ère du numérique
La deuxième dynamique que j’observe concerne le passage d’un aspect physique à un aspect virtuel dans les projets de la route de la soie numérique.
En effet, tout comme les acteurs privés, l’aspect virtuel des projets n’était pas au centre des BRI ; en revanche, les infrastructures physiques (ponts, ports, routes, matières premières), constituaient l’essentiel de l’intérêt des investisseurs publics chinois.
Même lorsque les trois ministères chinois ont proposé la notion de « route de la soie informatique » en 2015, l’accent portait uniquement sur les réseaux de fibres optiques. L’attention portée à l’e-commerce, à l’intelligence artificielle, au cloud, aux villes intelligentes et aux centres de données a été introduite au fur et à mesure de l’augmentation du poids des acteurs privés dans les stratégies nationales chinoises.
Aujourd’hui, la route de la soie numérique inclut non seulement les infrastructures de télécommunication de base, mais aussi, et surtout, des projets numériques virtuels. Par exemple, en Malaisie, ce sont les projets de fintech qui dominent, tandis qu’à Singapour, ce sont les centres de données.
Le privé à l’avant-scène
La troisième dynamique concerne enfin la relation d’interdépendance entre le gouvernement chinois et les entreprises privées chinoises dans le secteur numérique.
D’un côté, le gouvernement chinois recourt de plus en plus aux entreprises privées pour réaliser ses stratégies d’État. Dans le cas de la route de soie numérique, l’objectif est de réduire les dépenses (de nombreux projets de BRI réalisés par les entreprises publiques ne sont pas financièrement rentables), et de pallier leur manque d’expertise dans le secteur numérique.

Avant le premier mandat de Xi Jinping en 2012, les acteurs privés n’étaient jamais mentionnés dans les plans quinquennaux de la Chine. Le 14ᵉ Plan quinquennal (2021-2025), qui marque le début de la réalisation du deuxième objectif centenaire du gouvernement chinois, à savoir la construction de l’État moderne socialiste, a néanmoins changé les choses. Les investisseurs privés sont désormais non seulement encouragés à prendre part aux domaines jadis monopolisés par les entreprises d’État, tels que la télécommunication, mais également incités à jouer un rôle actif dans les stratégies d’État, comme la BRI.
Du côté des entreprises technologiques chinoises, leurs relations avec le gouvernement chinois sont parfois délicates. Certes, elles jouissent d’une certaine agentivité dans le domaine numérique, là où le gouvernement a besoin d’elles. Ces entreprises contribuent à donner un nouvel élan à l’économie chinoise et à renforcer le poids de la Chine dans l’industrie et la gouvernance numérique mondiale.
Cependant, ces leviers économiques et technologiques semblent fragiles. Rappelons, par exemple, que le président chinois Xi Jinping a récemment imposé aux géants chinois des technologies une période de 32 mois de sanctions à la suite de pratiques soi-disant déloyales.
Une liberté contrôlée
Si l’économie est toujours associée à la politique et que la sphère nationale est reliée à la sphère internationale, le gouvernement chinois semble bien maîtriser les règles du jeu.
À l’ère de la route de la soie numérique, le gouvernement chinois se met en retrait et laisse ses champions nationaux libres dans leur conquête des marchés internationaux, désormais présents sur l’ensemble de la chaîne de production.
Cependant, il veille toujours à ce que la politique capture l’économie, et jamais l’inverse.