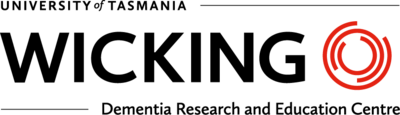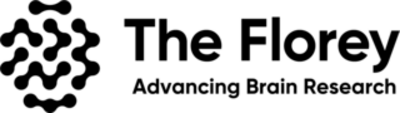Si vous lisez les médias traditionnels, vous avez croisé leur regard ces dernières semaines. Sans doute êtes-vous familiers de ces images dans lesquelles un enfant regarde droit dans l’objectif du photographe.
Bien que ces photographies soient largement utilisées par les médias, la légitimité de leur usage ne fait pas l’unanimité.
Ces photographies prises dans des pays détruits par la guerre vous ont profondément émus tant les sentiments évoqués étaient vifs : souffrance, peur, détresse. Peut-être avez-vous encore en mémoire l’image du petit garçon d’Alep, en Syrie, le visage couvert de poussière, de cendres et de sang, le regard à la fois fixe et absent, sonné par les bombardements auxquels il vient de survivre.
De regard en regard, ces photographies ont construit un genre médiatique.
Il est vrai qu’il existe des directives éthiques qui guident l’usage des photographies de presse. Mais les intentions humanistes qu’elles affichent cachent le fait qu’elles sont aussi des produits échangés sur les marchés de l’information. Ainsi, une récente recherche a souligné l’urgence de s’interroger sur les fins qu’elles servent et les chercheurs recommandent de demeurer circonspect à leur égard.
Professeure agrégée en culture et linguistique appliquée à l’Université Simon Fraser, mes recherches portent sur le langage dans les films et les médias, les idéologies qu’ils construisent et leur rôle dans le maintien des préjugés à l’égard des groupes ethniques et minoritaires. Dans mon enseignement, j’attache une grande importance au développement d’un regard critique. Il est essentiel de savoir décrypter les images de l’actualité et les personnes qu’elles dépeignent, comme les enfants.
Une réalité sans fard
Les nouvelles des conflits lointains nous parviennent à travers des comptes-rendus, images, fragments sonores ou vidéos. Un événement devient réel parce qu’il est photographié. Mieux que des mots, les photographies des ruines qui accompagnent les images de victimes illustrent les dégâts de la guerre, nous renvoient à sa dure réalité.
Mais quelle vérité cherchons-nous dans ces regards d’enfants ? Dans ces images prises sur le vif ? Celles d’émotions sans fard ni feinte, plus vraies parce que ce sont celles d’enfants ?

La guerre est dans le regard de l’enfant que regarde le lecteur. Et pourtant, l’essayiste américaine Susan Sontag a fameusement rappelé que la photographie n’est jamais transparente, qu’elle est toujours l’image que quelqu’un a choisie : une image cadrée qui exclut. Il est à cet égard impératif, comme je l’enseigne à mes étudiants, d’interroger les ressources iconographiques des articles de presse et de tenir compte de l’historique de ces représentations ainsi que des conditions de leur diffusion.
Considérant l’histoire de la photographie, on peut penser que cet engouement des médias pour les photos d’enfants trouve son origine dans la photographie d’art. Pensons par exemple aux célèbres clichés en noir et blanc de Robert Doisneau ou à l’enfant au petit chien de André Kertész dont le critique littéraire français Roland Barthes notait le regard qui transperce.
Être témoin de la souffrance d’autrui
Le regard à la caméra a sans doute pris une autre fonction dans les médias : interpeller les lecteurs. On aura en mémoire le cliché célèbre de la jeune fille afghane de Steve McCurry et l’inoubliable Phan Thi Kim Phuc, jeune victime de la guerre du Vietnam.
Le XXe siècle semble ainsi nous avoir donné cette tâche d’être témoin de la souffrance des autres. Afin de mieux assumer cette responsabilité, il conviendrait de s’interroger sur les fonctions que jouent ces images.

Déjà des milliers d’abonnés à l’infolettre de La Conversation. Et vous ? Abonnez-vous aujourd’hui à notre infolettre pour mieux comprendre les grands enjeux contemporains.
Un des rôles pleinement assumés des médias est celui de « rapporteurs » des violences, crimes et exactions commis à travers le monde. La photographie devient alors une preuve de ce qui a pris place : le fameux « ça a été » de Roland Barthes. Mais plusieurs limites s’opposent ici à cette mission honorable : les genres qui influencent leur interprétation, leur marchandisation et leur réel impact.
Un genre de l’imagerie des conflits
La photographie d’enfant est un des genres incontournables de l’image de presse. Il existe une esthétique : des poses, des cadrages, mais aussi des marques dont le lecteur est familier. C’est un genre qui connait aussi des sous-genres, lesquels varient en fonction de la zone géographique des conflits.
Ainsi, les images d’enfant dont le visage est couvert d’un masque de poussière, les traits déformés par l’angoisse et la douleur, sont devenues la représentation intemporelle des conflits au Moyen-Orient. Ces photos sont à ce point interchangeables que certaines d’entre elles, issues de conflits passés, sont utilisées pour illustrer des conflits récents.

Pour concevoir l’article que vous avez sous les yeux, j’ai consulté des banques d’images dans lesquelles ces photographies apparaissent en rangs, classées sous des propositions de recherche. C’est par exemple ici « Gaza enfants », là « Conflits Moyen-Orient ». Chaque image est associée à des mots-clés qui éclairent la manière dont est facilitée la sélection d’images, comme « pauvre enfant affamé pleurant », ou encore « sale et pauvre ».
Il m’a même été proposé des images réalisées par l’intelligence artificielle. Bien que leur usage soit encore peu fréquent dans les médias, leur présence dans de telles banques d’images n’en reste pas moins inquiétante.
Une marchandise sur le marché de l’information
Les diktats de l’image spectaculaire et les contraintes du photojournalisme ont rendu problématique l’usage des photographies d’enfants. Ces images ont ainsi pris pour fonction de se signaler dans le flot de titres qui défilent sur les fils d’information de nos écrans. En conséquence, le désir d’attirer toujours plus de lecteurs menace l’éthique qui devait guider ces pratiques.
La photographie d’enfant est devenue une marchandise parce qu’elle est achetée pour illustrer un article et parce qu’elle contribue à l’attention qui lui sera accordée. Mais ce qui est monnayé est alors la douleur des victimes.
En novembre 2023, le chef de l’ONU, Antonio Guterres, dénonçait que la bande de Gaza était devenue « un cimetière pour les enfants ». Un an plus tard, les Nations Unies annonçaient que près de 70 % des victimes étaient des femmes et des enfants, dont la plus grande catégorie est celle des enfants de 5 à 10 ans. Considérant qu’en l’espace d’un an, les lecteurs auront consommé des centaines d’images, il est essentiel de s’interroger sur l’efficacité de leurs usages.
Certaines personnes, qui croient fermement au pouvoir de l’image, objecteront que la fin justifiant les moyens, tout est bon pour faire prendre conscience aux lecteurs de l’inhumanité des conflits qui prennent pour cible des enfants. Mais ces images qui tirent profit de l’empathie du lecteur en simplifiant et en instrumentalisant la détresse humaine atteignent-elles vraiment leur but ?
En effet, on a de longue date questionné le pouvoir réel des images-chocs. Les photographies qui font spectacle de la souffrance contribuent au désengagement de spectateurs devenus insensibles.
Il est temps de s’interroger sur les véritables effets de ces images. Des recherches en psychologie ont justement montré que ce sont les photographies d’enfants heureux qui ont le plus d’impact sur les lecteurs.
On peut se demander si les photographies des conflits que nous connaissons n’ont pas au final pour effet de consoler les lecteurs de leur impuissance. En effet, ces images leur permettent aussi de participer à la douleur qu’elles représentent puisqu’en éprouvant de l’empathie, ils et elles souffrent aussi.

Bousculer l’état des lieux
Devant la léthargie grandissante des instances internationales, on a aussi remarqué une évolution concernant les photographies choisies par les journalistes.
On peut à cet égard prendre l’exemple du Guardian, qui a utilisé des portraits d’enfants souriants prises avant leurs morts. Ce geste journalistique affiche la volonté des auteurs de l’article de nous amener à repenser cet imaginaire photographique.
Toute photographie d’enfant porte en elle une relation avec le futur qui amène à envisager l’adulte qu’il ou elle sera. Toutefois, ces images qui montrent le « ça a été » nous disent également : « ça ne sera pas ». Et pour cela, elles en sont d’autant plus poignantes.