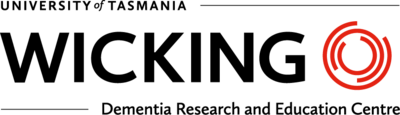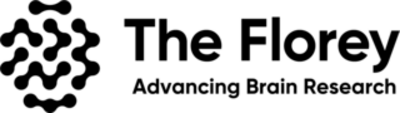Sans science, il n’y a pas de justice sociale. C’est ce qu’a déclaré la présidente de l’Académie brésilienne des sciences, en clôturant le Forum S20, une coalition d’Académies des sciences des pays du G20, qui s’est réunie sous la direction du Brésil en juillet dernier.
On en a peu entendu parler, mais ce forum a donné lieu à une déclaration et à des recommandations sur cinq thèmes, qui ont été acheminées aux dirigeants du G20 en accord avec l’agenda 2030 des Nations unies pour le développement durable : (1) intelligence artificielle ; (2) bioéconomie ; (3) processus de transition énergétique ; (4) défis de santé ; et (5) justice sociale. Plusieurs de ces thématiques ont été reprises dans la Déclaration des dirigeants du G20 à Rio de Janeiro.
Le développement des sciences, de la technologie et de l’innovation (STI) est une question importante pour toutes les sociétés. Car sans les sciences, on ne pourra pas atteindre les objectifs de développement durable ou lutter contre le changement climatique, par exemple.
Il est donc impératif que la science gagne de plus en plus de place dans les forums internationaux, qu’ils soient scientifiques, politiques ou économiques.
Mais les dirigeants internationaux accordent-ils l’attention voulue à cette nécessité ?
Candidate au doctorat en science politique à l’Université de Montréal, je travaille sur la diplomatie scientifique dans les pays émergents et je m’intéresse à l’internationalisation des STI.
La place de la science au G20
Heureusement, les derniers sommets du G20 montrent que des efforts pour intégrer la science sont, en fait, déployés.
Rappelons ce qu’est le G20 : il s’agit d’un forum de coopération économique et de dialogue international qui regroupe 19 pays plus l’Union européenne et l’Union africaine. Ensemble, ces pays représentent 85 % du produit intérieur brut mondial.
Créé en 1999, le groupe n’a pas de constitution formelle et la présidence tourne entre les pays membres.

En 2024, le Sommet a eu lieu entre 18 et 19 novembre à Rio de Janeiro, sous la présidence brésilienne.
Le G20 a une structure basée sur deux volets principaux, celui des Sherpas et celui des finances. Tout au long de l’année, les membres des deux volets consultent des groupes d’acteurs concernés, connus comme groupes d’engagement. Ce sont des groupes thématiques qui favorisent la participation de la société civile et des acteurs non gouvernementaux, dont le S20 fait partie. Ensemble, ils collaborent pour organiser le programme et les discussions du sommet des dirigeants.
Les pays émergents à la présidence
Avoir la présidence du G20 est stratégique pour les pays émergents. C’est la possibilité de définir l’ordre du jour et les objectifs qui guideront les discussions tout au long de l’année. Le Brésil a pris le relais après l’Inde et sera suivi par l’Afrique du Sud.
D’une part, c’est un moment unique pour les pays émergents de fixer leurs priorités sur l’ordre du jour international et d’influencer fortement l’orientation des discussions politiques.
De plus, les pays en question sont membres des BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud), dont certains traversent une période d’expansion. Cela aide à renforcer la légitimité de ses priorités.
La transition vers un monde multipolaire crée des tensions, mais ouvre également de nouvelles possibilités aux pays émergents.
D’autre part, pour se projeter à l’international, les pays émergents utilisent de plus en plus la recherche et l’innovation. Les STI gagnent une place prioritaire dans les politiques scientifiques nationales des pays émergents en ce moment, très influencés par les leçons apprises pendant la pandémie de la Covid-19 sur l’importance de développer ses compétences de recherche.
Le rôle social des scientifiques
En outre, les scientifiques prennent conscience de leur rôle social et de ses capacités d’influencer les politiques publiques fondées sur des données probantes et élaborées en fonction des réalités locales.
Ces dynamiques, du local au global, sont alors transposées au G20.

Déjà des milliers d’abonnés à l’infolettre de La Conversation. Et vous ? Abonnez-vous aujourd’hui à notre infolettre pour mieux comprendre les grands enjeux contemporains.
Il faut remarquer que les sujets de STI sont transversaux dans les défis internationaux actuels. Dans le G20, cependant, ils ont deux groupes dédiés : le groupe d’engagement scientifique, appelé Science 20, qui regroupe les académies des sciences des pays membres et invités, et le groupe de travail récemment créé sur la recherche et l’innovation (RIWG), sous la coordination des ministres de la Science, de la Technologie et de l’Innovation et en liaison avec les Sherpas.
Le RIWG a tenu sa première réunion ministérielle de l’histoire en septembre de 2024, un héritage important de la présidence brésilienne au G20 et a approuvé la Déclaration de Manaus sur l’innovation ouverte.
À l’occasion, la ministre brésilienne de la Science, de la Technologie et de l’Innovation, Luciana Santos, a indiqué que l’objectif est la construction de solutions pour l’accès et le transfert de technologies vers les pays en développement, en réduisant les inégalités et en favorisant un mouvement économique inclusif, juste et durable.
Objectifs nobles, réalité complexe
Dans un contexte géopolitique de plus en plus difficile, utiliser la science, la technologie et l’innovation comme pont semble montrer la « lumière au bout du tunnel » et renouveler l’optimisme, quoique timide, face à plusieurs obstacles dans la gouvernance mondiale existante et une compétition technologique accrue.
Les consensus scientifiques sont difficiles à traduire en consensus politiques et les décideurs ne comprennent pas toujours l’importance des sciences dans le politique. En ce sens, disposer d’un forum de coopération économique comme le G20 ouvrant davantage d’espace à la recherche et à l’innovation est un signe positif.
Il convient de rappeler que les déclarations du G20, y compris de ses groupes de travail et d’engagement, sont consensuelles. Collaborer pour le bien commun, le développement et la réduction des inégalités reste un sujet sur lequel des pays comme les États-Unis et la Russie parviennent à s’entendre. Même si, dans la pratique, la coopération scientifique entre les deux pays a été réduite depuis le début de la guerre russo-ukrainienne.
Le G20 et la diplomatie scientifique
Le G20 apparaît donc comme un cas intéressant qui nous permet d’illustrer la pratique de la diplomatie scientifique.
Si les STI sont abordées par les groupes de travail, directement liés aux gouvernements, elles sont également abordées par le G20 social, lié à la société civile.
Le G20 devient alors une bonne interface entre la science, la société et le politique qui aide les différentes parties prenantes à dialoguer.
La diplomatie scientifique, ainsi, peut renforcer le développement économique et social souhaité par les membres du G20 et devrait servir davantage à collaborer qu’à rivaliser.